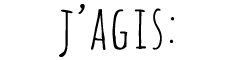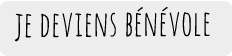En 2024, 330 000 personnes sont sans domicile dont 120 000 femmes. Soit deux fois plus qu’il y a dix ans. On considère que chaque nuit, 3000 enfants dorment dans la rue en France.
Ces chiffres ne sont que données indicatives. Invisibilisées, il est difficile de les dénombrer. Pourtant, elles existent bel et bien et leurs problématiques sont multiples et violentes.
Pourquoi les femmes sans-abri sont plus vulnérables ?
La précarité des femmes sans domicile fixe est une réalité souvent ignorée, à la fois dans l’espace public et dans les politiques sociales. Moins visibles que les hommes dans la rue, les femmes sans-abri cumulent pourtant les vulnérabilités. À l’intersection de la pauvreté, de l’exclusion et des violences faites aux femmes, leurs problématiques sont multifactorielles.
Si les violences faites aux femmes sont une problématique représentée dans la société française, elle n’épargne évidemment pas cette catégorie de la population.
Pire encore, à la rue, leur condition de femme les expose à plus encore de danger.
La prostitution, le risque d’exploitation, les grossesses à risque, le renoncement au soin par le rejet de soi-même sont autant de problématiques rencontrées par les femmes sans abris.
Chacune d’entre elles ou presque a déjà subi des violences. Plus de 90 % des femmes vivant dans la rue ont été victimes de violences, selon une étude menée en 2016 par l’Observatoire du Samusocial de Paris. Ces violences incluent des insultes, exploitations, agressions, et viols.
Violences, santé, isolement
Les femmes sans domicile sont exposées à un risque accru de violences, qu’elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques.
Si l’idée selon laquelle les femmes à la rue sont plus vulnérables est répandue, elle reste toutefois largement ignorée et peu documentée. Pourtant, les agressions dont elles font l’objet ne sont pas rares et isolées.
Par ailleurs, les enquêtes qui traitent des violences faites aux femmes excluent cette partie de la population car elles ne concernent pas les femmes sans abri.
Etre une femme sans abri c’est être en situation de veille permanente. Pour certaines, dormir la nuit n’est pas une option. Et ce, pour assurer leur survie. Les agressions sexuelles des femmes à la rue relèvent plus de la règle que de l’exception.
Elles vivent l’insécurité de la rue au quotidien et ne trouvent que rarement le repos.
Elles sont aussi, très souvent, confrontées à la violence sexiste et sexuelle dans les centres d’hébergement.
Vulnérables par leur condition physique, de santé ou fragilisées par les addictions, ces femmes ne sont pas toujours en mesure de se défendre. Le manque d’argent les pousse parfois à accepter de faire de leur corps une monnaie d’échange.
Certaines d’entre elles en viennent aussi à prendre de la distance avec ce corps qui, ayant subi des maltraitances, ayant été humilié, ne leur apparaît plus digne de valeur.
Pour nombre d’entre elles, la rue est à la fois une conséquence et une prolongation de violences conjugales ou intrafamiliales. Fuir un conjoint violent ou un partenaire abusif est souvent le premier pas vers l’errance.
En 2012, 36 % des femmes à la rue déclarent avoir été victimes de violence avant 18 ans contre 19 % des hommes.
L’isolement aggrave encore ces situations. Rompre avec les réseaux familiaux ou sociaux est parfois nécessaire pour échapper aux violences, mais cela rend l’accès à l’aide plus difficile. Nombre de femmes victimes ne portent pas plainte, par peur de représailles ou faute de solution alternative. La mémoire traumatique, l’absence de prise en charge adaptée et la méfiance envers les institutions renforcent le silence autour de ces parcours.
Côté santé, les conséquences peuvent être dramatiques. L’exposition au froid, le manque d’hygiène, les troubles psychiques liés aux violences subies, les grossesses non suivies ou les maladies chroniques non soignées frappent plus durement les femmes que les hommes.
Le manque de soins spécifiques pour les femmes en grande précarité est une problématique persistante, malgré les alertes des associations de terrain.
Besoins spécifiques et dispositifs d’accueil adaptés
Les femmes sans-abri ne peuvent être accompagnées efficacement sans une prise en compte de leurs besoins spécifiques. La précarité féminine requiert des réponses ciblées, respectueuses de leur dignité et de leur sécurité.
Hygiène, maternité, sécurité
Accéder à l’hygiène est un défi quotidien pour les femmes à la rue. L’absence de lieux sûrs pour se laver, se changer, gérer les menstruations ou bénéficier de soins gynécologiques accroît leur vulnérabilité. Ces conditions sont parfois à l’origine de violences supplémentaires, notamment sexuelles, dans des squats ou centres mixtes non sécurisés.
Les femmes enceintes ou avec enfants sont particulièrement exposées. En situation d’extrême précarité, certaines peuvent être contraintes à des choix douloureux.
Certains dispositifs d’accueil intègrent la maternité dans leur prise en charge : suivi médical, hébergement adapté, soutien psychologique, protection de l’enfant.
La sécurité est une priorité majeure. De nombreuses femmes évitent les centres d’hébergement de peur d’y retrouver leur agresseur, ou de subir des violences sexistes dans des dortoirs partagés.
Des structures réservées aux femmes, avec du personnel formé à l’accueil de victimes de violences conjugales et sexuelles, permettent une reconstruction dans un environnement protégé.
L’action de La Mie de Pain auprès des femmes en détresse
Face à cette réalité invisible et violente, l’association La Mie de Pain œuvre chaque jour pour offrir une réponse humaine, globale et digne aux femmes en situation de grande précarité. Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’inclusion, elle s’engage pour lutter contre les violences faites aux femmes, et accompagner chacune dans leur reconstruction.
Programmes ciblés et accompagnement global
Les programmes de La Mie de Pain sont conçus pour répondre aux multiples formes de violence subies par les femmes sans-abri. Qu’il s’agisse de violences conjugales, de harcèlement sexuel dans l’espace public ou d’agressions sexuelles passées, chaque femme accueillie bénéficie d’une écoute bienveillante et d’un accompagnement personnalisé.
L’association s’appuie sur un réseau de professionnels et de bénévoles formés aux enjeux de la violence faite aux femmes : travailleurs sociaux, psychologues, animateurs…Ensemble, ils construisent un parcours de sortie de la rue, fondé sur la protection, la reconstruction et l’autonomie.
La Mie de Pain travaille également en lien avec d’autres structures de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, afin de faciliter les démarches juridiques (dépôt de plainte, ordonnance de protection), l’accès aux soins, ou l’orientation vers des lieux de vie stables et sécurisés.
Nos foyers pour femmes à la rue
Concrètement, La Mie de Pain accueille 160 femmes en détresse dans 4 structures pensées pour elles. Ces espaces exclusivement féminins offrent un hébergement temporaire (un mois renouvelable) ou plus pérenne avec un principe de non remise à la rue, un accès à l’hygiène, aux repas, à des soins médicaux et psychologiques. Les femmes victimes de violences domestiques ou ayant subi des violences sexuelles trouvent ici un premier refuge, où elles peuvent commencer à se reconstruire.
La Mie de Pain grâce à son engagement, participe activement à la lutte contre les violences faites aux femmes, afin de sensibiliser le public à la précarité féminine et de porter la voix de celles qui n’osent pas toujours parler de la violence qu’elles subissent. L’association organise également des activités sportives et culturelles, séjours, groupes de parole afin de permettre à ces femmes de se reconstruire, prendre un nouveau départ et quitter le foyer.
Mettre fin aux violences faites aux femmes passe aussi par une meilleure visibilité de leur précarité. Les femmes à la rue ne sont pas seulement en errance, elles sont souvent en danger. Leur redonner un toit, un soutien, une écoute et des droits, c’est refuser qu’elles soient les grandes oubliées de la lutte contre les violences. Cet engagement fait partie des combats quotidiens menés par la Mie de Pain.
Si vous souhaitez soutenir ce combat, vous pouvez faire un don. Quel que soit le montant, chaque euro compte et participe à faire avancer le combat contre la précarité et pour la dignité.